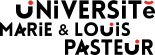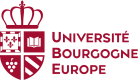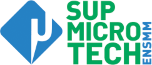Ce projet de thèse vise à étudier la déformation active dans l’Arc du Jura, en utilisant des données géophysiques récentes (GNSS et sismologiques). Un des objectifs est de distinguer la déformation de la couverture sédimentaire de celle du socle (déformation « thin skin » ou « thick skin »). Le projet permettra d’estimer les taux de glissement des failles actives, notamment la faille du Vuache, afin d’évaluer leur contribution à l’aléa sismique, en particulier dans des zones sensibles comme la centrale nucléaire du Bugey. Un volet exploratoire de la thèse examine les liens entre déformation crustale et réservoirs d’eau souterraine dans le massif du Jura, avec un focus sur l’aquifère karstique de Fourbanne, site multi-instrumenté à l’interface entre plusieurs SNO. L’objectif est d’étudier le lien entre variations hydrogéologiques, déformation de surface et sismicité, contribuant ainsi à une meilleure caractérisation des ressources en eau et de l’aléa sismique dans la région.
Contexte
Le massif du Jura est un cas remarquable de “fold-and-thrust belt”, une chaîne de plis et chevauchements, développé dans la couverture sédimentaire au-dessus d’un niveau de décollement avec le socle (une couche ductile de sels et évaporites triasiques) ; c’est le modèle d’une tectonique thin-skin. Les axes de plis et chevauchements qui accommodent le raccourcissement sont allongés selon une forme arquée qui définit les axes du relief actuel. Ce schéma de premier ordre est perturbé par des failles décrochantes transverses à la direction principale des structures compressives. De même, il n’est pas exclu que certaines structures repérées en surface se prolongent en profondeur dans le socle, sous le niveau de décollement (e.g. Baize et al., 2011). L’arc est réputé être l’ensemble le plus récent témoignant de la tectonique compressive alpine. Des datations U-Pb sur les tectoglyphes calcitiques associés aux décrochements et chevauchements jurassiens confortent l’hypothèse de déformations synchrones le long des chevauchements et des failles décrochantes, dans les phases syn- et tardi-orogéniques, au Miocène et jusqu’à la fin du Pliocène (Smeraglia et al., 2021).
L’Arc du Jura est dans son ensemble une zone modérément sismique, avec quelques zones plus actives dans les périodes historiques et instrumentales (Larroque et al., 2021). On peut par exemple citer les alentours de la faille décrochante de la Montagne du Vuache au sud (e.g. Thouvenot et al., 1998 ; Baize et al., 2011), les Avant-Monts avec le séisme de Besançon/Roulans (ML 4.8, 23/02/2004 ; Baer et al., 2005) ou encore la région frontalière avec la Suisse dans le NE (Porrentruy, Montbéliard) qui a connu plusieurs événements significatifs en mécanisme inverse dans les trois dernières années (ML 4.1 24/12/2021, ML 4.2 22/03/2023 ; Sira et al. 2022, Rénass). D’un point de vue général, la région SW est dominée par des séismes superficiels à très superficiels, qui semblent pour l’essentiel se produire dans la couverture décollée, tandis que des événements plus profonds (> 25 km) sont observés dans le NE. L’activité sismique suit un régime décrochant ou inverse contrôlé par un axe de raccourcissement NW-SE (Rabin et al., 2018).
Les observations de la déformation sismique de l’Arc du Jura, basées sur les événements épars enregistrés, peuvent être complétées par le champ de déformation superficielle continu, mesuré par géodésie spatiale. Ainsi, dans les années 2000, l’IRSN (l’IPSN à l’époque) a développé un réseau de 6 sites instrumentés en GPS de précision géophysique grâce à des mesures semi-permanentes dans la partie méridionale de l’Arc du Jura. L’objectif était de mesurer d’éventuels déplacements relatifs de blocs tectoniques préalablement définis à partir du schéma structural. Par exemple, deux blocs étaient définis autour de la faille de la Montagne du Vuache, avec un site GPS sur chacun des deux blocs.
La stratégie de mesure visait à concilier les avantages des réseaux permanents, avec des monuments stables et robustes, et ceux des réseaux temporaires avec un nombre d’instruments minimal pour une couverture géographique optimale, pour réduire les coûts des instruments. Ainsi, l’IRSN avait développé des socles métalliques soudés dans la roche pour une bonne stabilité et des mâts métalliques de 1,20 m avec un système de centrage forcé pour améliorer l’ergonomie et la répétabilité des installations. Le dispositif assure une bonne stabilité et minimise les masques végétaux.
Des mesures des six monuments ont été effectuées une à deux fois par an entre les années 2000 et 2010. Une première estimation des champs de vitesses du réseau a été produite sur la première moitié de la période (Walpersdorf et al., 2006). Les résultats majeurs étaient un mécanisme de déformation dominé par de l’extension le long de l’arc, et une vitesse différentielle de 1 mm/an au travers la faille du Vuache, confirmant son glissement senestre. Les données accumulées ensuite entre 2006 et 2010 n’apportaient pas de réelles améliorations des résultats sur le plan du champ de vitesses et une mise à jour des résultats de 2006 n’était pas encore possible. En 2024, une nouvelle campagne de mesure du réseau semi-permanent a été effectuée (projet INSU Tellus Juramotion, PI A. Walpersdorf) pour apporter des nouvelles contraintes fortes sur les taux de déplacement de ces stations couvrant le sud Jura, en prolongeant l’intervalle de mesures géodésiques sur 24 ans. Au-delà de ce réseau GNSS semi-permanent, le réseau GNSS national permanent (SNO Rénag) a été densifié pour compléter l’unique station historique du Jura, installée en 2000, par un réseau régional GPS-JURA avec 5 stations installées en 2013-2014 (OSU THETA, PI Christian Sue). Ce réseau densifié contraint maintenant, grâce à plus de 10 années de mesures continues sur l’ensemble des stations, des vitesses significatives (à ± 0.2 mm/an). Le déploiement de ce réseau permanent a été fait de façon parfaitement complémentaire au réseau GNSS semi-permanent de l’IRSN.

Tout comme pour la couverture géodésique, le Jura était également une zone blanche au niveau instrumentation sismologique. La densification et rénovation du réseau large bande (RLBP) de l’IR Résif-Epos (maintenant Epos-France) à partir de 2018 a permis l’installation d’une dizaine de stations dans la région. Ces stations sont complétées par le réseau local JURAQUAKE autour d’une zone karstique sismiquement active au nord-est de Besançon et site du séisme de Roulans de 2004, avec 6 stations installées également en 2018 par l’OSU THETA (région FC, PI Julie Albaric) (Fig. 1). Cette cible particulière, le karst de Fourbanne, a également profité d’une instrumentation dense dans le cadre du projet SISMEAUCLIM en 2021-2022 (région BFC, PI Julie Albaric), avec le déploiement de 60 nodes sismiques du parc national SISmob, d’un réseau de pluviomètres et d’une fibre optique souterraine (FIBROKARST, OSU THETA, PI Julie Albaric, collab. EOST). La thèse d’Anthony Abi Nader (UFC, soutenue en 2023) associée à ce projet a porté sur l’exploitation hydrogéologique de ces mesures. Leur analyse sous des points de vue sismo-tectoniques reste donc à faire, tout comme l’exploitation des six premières années de mesures sismologiques permanentes dans le Jura, à partir des réseaux RLBP et JURAQUAKE. Cette nouvelle couverture de l’Arc du Jura par les réseaux observationnels locaux et nationaux nous permettra de contribuer à de nombreux débats scientifiques au sujet de sa déformation actuelle. Les questions en suspens concernent par exemple l’origine des forces géodynamiques mises en jeu, et la manière dont la déformation actuelle du massif s’inscrit dans le cadre régional incluant les Alpes et le Graben du Rhin.
Les aquifères karstiques sont des réservoirs d’eau potable de première importance pour la population, aussi bien au niveau mondial que national, et en particulier dans le massif du Jura où 80% de l’eau potable en est extraite (Bakalowicz, 1999). Le massif du Jura fait par ailleurs partie des sites du Service National d’Observation KARST (labellisé INSU) et représente la Zone Atelier « Arc Jurassien » de l’Infrastructure Nationale OZCAR/LTER France. Nous bénéficions ainsi pour cette thèse d’une base de données hydrogéologiques importante qui pourra aider à interpréter certaines fluctuations dans nos mesures sismologiques et géodésiques et d’affiner notre compréhension des déformations crustales faibles qui affectent l’arc du Jura.
Programme de travail de la thèse
La thèse demandée dans ce projet débutera par l’exploitation des données du réseau GNSS semi-permanent sur la durée totale de 24 ans. Grâce à ce long intervalle d’occupation, avec des incertitudes de mesure de 2-3 mm par campagne, ces mesures semi-permanentes devront nous permettre de contraindre des taux de déplacement inférieurs à 0.25 mm/an. La combinaison des mesures GNSS semi-permanentes avec les (nouvelles) données permanentes devrait permettre d’estimer un champ de déformation actuelle 3D avec une résolution spatiale inégalée jusqu’ici, qui aidera à évaluer les taux de glissement actuels des failles majeures de l’Arc du Jura.
Les données sismologiques seront analysées pour obtenir la localisation fine de la sismicité et les mécanismes au foyer associés. Ainsi, on pourra comparer le style et l’amplitude des déformations géodésiques et sismiques, en s’appuyant en particulier sur les nouveaux mécanismes au foyer. Une dernière base de données de mécanismes au foyer date de la thèse de Mickaël Rabin, soutenue en 2016, donc antérieure à la densification du réseau sismologique du massif du Jura. Notre approche combinée géodésique-sismologique permettra ensuite l’étude de structures et phénomènes particuliers, comme la faille du Vuache ou encore la sismicité récente dans la région de Porrentruy/Montbéliard (proche de la station GNSS BLVR), à l’interface avec le fossé Rhénan (plusieurs séismes de magnitude 3.6 à 4.1 entre fin 2021 et 2023). En particulier, l’analyse conjointe des données géodésiques et sismologiques, enregistrées localement et accumulées au sein des SNOs INSU, apportera de nouvelles contraintes sur l’estimation de l’aléa sismique dans cette région de l’arc du Jura.
Dans la deuxième partie plus exploratoire de la thèse, on analysera les variations temporelles des signaux GNSS et sismologiques, pour les comparer aux observations hydrogéologiques du site JURASSIC KARST du service national d’observation KARST, afin de déterminer des couplages potentiels entre différents mécanismes de déformation crustale.

Précision sur l’encadrement
La thèse se déroulera entre le laboratoire ISTerre Grenoble (pour l’encadrement en géodésie GNSS et la sismotectonique) et le laboratoire Chrono Environnement Besançon (pour les aspects sismicité et hydrogéologie). Un Comité de Suivi Individuel sera mis en place pour assurer le bon déroulement de la thèse.
Profil et compétences recherchées
Le (la) candidat(e) devra idéalement présenter une formation en sciences de la Terre, géophysique ou physique. Le(La) candidat(e) sera capable de s’adapter rapidement au travail avec des interlocuteurs issus de domaines de compétences variées. Un bon niveau d’anglais (parlé et écrit) est requis.
Contacts :
Bibliographie
- Baer, M., et al. (1999). Earthquakes in Switzerland and surrounding regions during 1998. Eclog. Geol. Helv., 92/2, 265–273.
- Baize, S., et al.., 2011. Contribution to the seismic hazard assessment of a slow active fault, the Vuache fault in the southern Molasse basin (France). Bulletin de la Société Géologique de France, 182 (4) : 347–365, DOI:10.2113/gssgfbull.182.4.347
- Bakalowicz, M. (1999). Connaissance et gestion des ressources en eaux souterraines dans les régions karstiques : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse., volume 1,13.
- Larroque C., S. Baize, J. Albaric, H. Jomard, J. Trévisan, M. Godano, M. Cushing, A. Deschamps, C. Sue, B. Delouis, B. Potin, F. Courboulex, M. Régnier, D. Rivet, D. Brunel, J. Chèze, X. Martin, C. Maron, and F. Peix, “Seismotectonics of southeast France : from the Jura mountains to Corsica,” Comptes Rendus. Géoscience, vol. 353, no. S1, pp. 105–151, 2021. DOI:10.5802/crgeos.69
- Rabin, M., Sue, C., Walpersdorf, A., Sakic, P., Albaric, J., & Fores, B. (2018). Present‐Day Deformations of the Jura Arc Inferred by GPS Surveying and Earthquake Focal Mechanisms. Tectonics, Vol. 37, Issue 10, pp. 3782-3804 DOI:10.1029/2018TC005047.
- Sira C., Grunberg M., M. Schaming, R. Dretzen, Séismes de Porrentruy (Suisse) du 24 et 25 décembre 2021. Rapport macrosismique, BCSF-Rénass 2022-R1, 37 pages, 11 figures, 1, tableau, 7 annexes.
- Smeraglia et al. (2021). U–Pb dating of middle Eocene–Pliocene multiple tectonic pulses in the Alpine foreland. Solid Earth, 12 (11), pp.2539-2551. DOI:10.5194/se-12-2539-2021.
- Walpersdorf, A., S. Baize, P. Tregoning, E. Calais and J.-M. Nocquet, Deformation in the Jura Mountains (France) : First Results from Semi-Permanent GPS Measurements, Earth Planet. Sci. Lett., Vol. 245, 365-372, 2006.